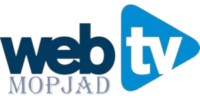L’annonce par Donald Trump d’une série de sanctions contre les responsables de la Cour pénale internationale (CPI) pour avoir émis un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense relance un vieux débat : la CPI est-elle un instrument de justice universelle ou une arme politique au service des puissances occidentales ?
Depuis sa création en 2002, la CPI a été perçue par de nombreux Africains comme un tribunal à géométrie variable, principalement tourné contre le continent. Plus de deux décennies après son entrée en fonction, un constat s’impose : l’écrasante majorité des enquêtes et des poursuites ont visé des dirigeants africains, tandis que les crimes commis par les grandes puissances restent souvent impunis.
L’Afrique, cible privilégiée de la CPI
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur les dizaines d’affaires instruites par la CPI, la majorité concerne des responsables africains : le Soudanais Omar el-Béchir, le Kényan Uhuru Kenyatta, l’Ivoirien Laurent Gbagbo, le Congolais Jean-Pierre Bemba, pour ne citer que ceux-là. Pendant ce temps, les crimes de guerre commis en Irak, en Afghanistan ou en Palestine par les États-Unis et leurs alliés ne font l’objet que de vagues enquêtes, souvent bloquées sous pression diplomatique.
Le cas israélien illustre parfaitement cette réalité. Lorsque la CPI a osé émettre des mandats d’arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, l’administration américaine, sous l’impulsion de Donald Trump, a immédiatement brandi des sanctions contre les juges et procureurs de la Cour. Où est donc cette sacro-sainte indépendance de la justice internationale ?
Un tribunal sous influence
La CPI est censée être un tribunal indépendant, mais elle demeure largement sous l’influence des grandes puissances. Son mode de fonctionnement repose sur des pressions diplomatiques et des calculs géopolitiques. Les États-Unis, pourtant non signataires du Statut de Rome, exercent un contrôle indirect sur la Cour en soutenant certaines enquêtes et en torpillant d’autres.
L’Union africaine, consciente de cette partialité, a plusieurs fois dénoncé l’acharnement contre ses dirigeants. En 2017, des pays comme le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie avaient même annoncé leur retrait de la CPI, avant que certains ne reviennent sur leur décision sous pression occidentale.
Il est temps pour l’Afrique de rompre avec la CPI
Face à cette situation, l’Afrique ne peut plus se contenter de simples protestations diplomatiques. Elle doit agir. Quitter la CPI serait un signal fort contre l’instrumentalisation de la justice internationale. L’Afrique doit renforcer ses propres institutions judiciaires, comme la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et privilégier des mécanismes de règlement des conflits endogènes.
Le continent doit cesser de dépendre d’une justice imposée de l’extérieur, souvent biaisée, et affirmer sa souveraineté juridique. L’heure est venue de prendre nos responsabilités et de mettre fin à cette soumission judiciaire qui ne sert que les intérêts des puissants.
L’Afrique doit quitter la CPI. Et elle doit le faire maintenant.
Manfouss BADIROU
- Spécialiste des Questions politiques Africaines
- Consultant en Communication Politiques